

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Georges Haldas : La légende du football (ed. L’Age d’Homme – 1981) « Qu’est-ce que vous pouvez bien trouver à une partie de football? Je me demande un peu ». C’est à cette question, que nous avons tous entendue sur tous les tons, qu’apporte sa réponse l’écrivain suisse Georges Haldas, poète et auteur de chroniques, d’essais et de traductions, récemment disparu à 83 ans, dans La légende du football (1981). Il ne cherche pas à justifier sa passion du football à ceux qui y sont hermétiques (et c’est leur droit le plus strict !) : « une passion ne s’explique pas. Elle se vit […]. La seule chose qu’on puisse faire, quand la passion vous tient, c’est d’en témoigner ». |
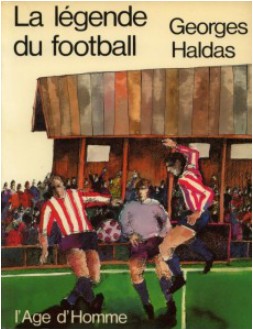 |
Tout commence dans l’enfance Dans son préambule, une première réflexion, évidente pour ceux _ et ils sont nombreux sur la planète _ touchés par cette ardeur : « L’engouement de la plupart des hommes pour le football est inconcevable sans le retour à l’enfance » (1). Il revit les parties improbables, sur des « terrains » improbables, avec des « ballons » improbables, de « football sauvage » dans son enfance. Pour lui, c’est dans ces moments de liberté et de jeu, hors des contraintes de la famille et de l’école, que se sont construits son caractère et son rapport aux autres. Il nous dresse alors des portraits typés de ses camarades de jeu : le buteur-né, le tout-bon organisant le jeu de l’équipe, le mauvais acceptant sans y croire d’être là parce que c’était un bon copain etc. Très drôle également son regard sur ces footballeurs en herbe imitant pour un public imaginaire, dans leurs beaux gestes comme dans leurs attitudes et tics les plus farfelus, les « grands joueurs » admirés lors des matches professionnels au stade, avec son père le dimanche après-midi : les gamins étaient en même temps eux-mêmes et le goal Franck Séchehaye ou l’avant-centre Raymond Passello [internationaux, grands joueurs du Servette de Genève dans l’avant-guerre]. Quant à lui, sans qu’il cache ses défauts, son plaisir, c’était, autant que de marquer un but, de « faire, de manière inspirée, jouer l’autre. Lui donner la possibilité de se réaliser et, par là-même, d’assurer un avantage à l’équipe » : cela esquisse en effet une personnalité… Il revient d’ailleurs sur « l’esprit d’équipe », en dépassant alors les limites du champ de jeu, dans une belle page de la partie finale. Tout au long de l’ouvrage, l’auteur effectue des «flash-back» : l’enfant accompagnant son père pour aller au stade dans une Genève depuis disparue sous l’urbanisme contemporain; en équipes de jeunes, les déplacements en car ou en voiture le dimanche matin dans des villages : le rituel de l’habillement de chacun dans des vestiaires minimalistes aux odeurs mêlées, des terrains frustes ; les matches d’ouverture, en catégorie « juniors », des matches du Servette. Le vert d’une pelouse, le ciel au-dessus des tribunes sont pour lui aujourd’hui autant de « madeleines » pour retrouver le temps perdu. Et, corollaire de ces souvenirs, des soupirs sur le temps qui passe… Un « grand match » ordinaire Le livre se présente comme le récit d’une demi-finale de Coupe de Suisse, bien plus tard, la cinquantaine passée, à laquelle a assisté Georges Haldas. Non pas pour en faire un reportage journalistique : on saura simplement que le match oppose les Rouges –le Servette de Genève vraisemblablement_ et des Blancs anonymes, et qu’il s’est terminé par une victoire 2-1 de l’équipe locale. A partir de cette trame (avant, pendant, après le match), il va nous faire découvrir l’univers du football, sur le terrain et dans les tribunes, comme jamais nous n’en avions eu une conscience aussi claire, grâce à son talent d’écrivain (par des mots simples et justes et un sens du rythme de la phrase), irrigué par la connaissance intime de ce jeu. Chaque page éclate de vie : les portraits de personnages humbles, les croquis des différents états de la foule, les dialogues captés, ses notations sur la relation entre joueurs et spectateurs rendent compte de la comédie humaine qui se joue à l’occasion d’un match. Bien sûr, il nous fait vivre les temps forts sur le terrain : le débordement d’un ailier, la préparation d’un but, le but marqué et la détresse du gardien battu, une « mêlée épique » dans la surface de réparation, le face-à-face entre le tireur de pénalty et le goal sont autant de moments de bravoure, constituant des scènes vivantes, drôles ou graves. Il sait relater les sensations d’un joueur, quel que soit son niveau, en action. Il met en particulier l’accent sur la principale qualité des grands joueurs : l’inspiration, fruit d’un don et du travail, dans un moment de grâce comparable à celle de l’artiste quand il improvise, il crée pour changer le cours attendu des choses. Des moments intenses Mais il va surtout montrer en quoi, le temps d’un match, ce qui n’est qu’un jeu, si inutile et insignifiant, transporte son public dans une autre dimension, un autre espace, un autre temps, hors des pesanteurs quotidiennes de l’existence, des problèmes personnels, des soubresauts de l’Histoire. Sans les faire disparaître évidemment: les passages sur « les temps morts » du jeu ou sur la mi-temps en témoignent, qui donnent une résonance « pascalienne » à ce divertissement. Pendant les actions, le public vit par procuration, sans le savoir. Il « réalise » à la perfection les gestes des grands joueurs, que lui-même dans son expérience de joueur amateur n’a pas réussis aussi bien, ou même n’a jamais tentés: «… le lourd public des stades, le temps que se développe une belle action, devient artiste ». L’auteur nous fait passer par toute « la gamme des émotions éprouvées, durant une rencontre, par le public. Des plus intimes, des plus cachées aux plus spectaculaires. Et même explosives », en liaison avec la chronologie et les péripéties d’un match. D’où vient l’intensité de ces émotions? Le temps d’un match est pour lui à l’image de la vie, dans son imprévisibilité, dans ses « renversements de situation » comme il s’en produit sur le terrain, dans ses changements de direction en dehors de notre volonté. Et il s’en réjouit: nous échappons aux rails sur lesquels veut nous engager une société «où s’accroît jour après jour, et jusqu’à l’asphyxie, l’empire de la prévision et la planification bureaucratique ». Nous retrouvons alors cette inspiration, « qui est l’essence de la liberté. Que chacun de ces spectateurs a connue, vécue, enfant ». Une vision lucide Idéalisme aveugle de poète? Dans le dernier chapitre de son œuvre, Georges Haldas nous dit qu’il est parfaitement conscient du pourrissement de ce jeu par sa commercialisation grandissante, et des tentatives de récupération politique par les gouvernements, éclatante dans les régimes totalitaires : « Mais à quoi bon y revenir ici. Chacun ayant conscience de ces changements, dans ce domaine aussi, liée à celle de nos jolies sociétés où le perfectionnisme technique repose sur un chaos psychique, mental, moral. Oui, cela, tout cela, qui ne le sait ». Il a bien vu également les débordements des supporteurs fanatiques: ses pages sur ceux-ci sont parmi les plus nettes que nous ayons lues sur le sujet. Mais son projet était de montrer « tout ce qui se cache de complexité humaine sous ce qu’on appelle communément, et non sans une nuance ironique et dédaigneuse, la passion du football ». D’expliquer pourquoi, malgré ce pourrissement, il continue à croire que chaque nouveau match pourra lui apporter ce surcroît de vie avec les autres, qui constitue l’essence du football. Une attitude de totale implication et de distance simultanées. Une dernière remarque : pourquoi ce mot « légende » du titre, si galvaudé pour des raisons commerciales bien souvent (chaque journaliste sportif un peu connu y allant de sa « légende de… », dans un style épique convenu) ? L’auteur s’en explique : après sa fin, le match renaît et reprend une nouvelle vie par les commentaires (pertinents ou oiseux) des spectateurs, par les écrits qui le fixent. Il a donc pris ce mot dans son sens étymologique latin de « ce qui doit être lu ». Son livre répond à cette définition. Pour conclure, à la fin de son ouvrage, il cite la phrase d’un ami à lui : «Au fond, parler de football, c’est parler de tout un aspect de l’humanité». Merci, Georges Haldas, d’en avoir si bien parlé ! (1) Il est à remarquer que ceux qui ont le mieux parlé (je veux dire avec ironie féroce et humour, sans intolérante acrimonie) de leur détestation du football, et pour lesquels nous avons (malgré tout !) une immense admiration, tels Pierre Desproges dans son sketch « A mort le foot ! » ou l’écrivain Umberto Eco dans sa chronique « Le Mundial et ses fastes » (La guerre du faux), font remonter cette aversion à l’enfance, où ils ont mal vécu leur rapport au football… Loïc Bervas (juillet 2011) |