

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| LE FOOTBALL, « UNE PESTE EMOTIONNELLE » ? (En réponse au livre de J-Marie Brohm et Marc Perelman – Folio Actuel) J-Marie Brohm et Marc Perelman ont placé en épigraphe de leur essai le vers célèbre de la fable de la Fontaine « Les animaux malades de la peste » : « Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés ». Frappés de quoi ? Par le football, « une peste émotionnelle »… Et pendant 390 pages ils crient leur détestation du football, et vouent aux gémonies tous ceux _ joueurs, spectateurs, journalistes, artistes, écrivains, intellectuels, politiques_ qui affirment leur plaisir de jouer et de regarder ce sport, ou expriment leur intérêt pour le football. Ils n’ont que mépris, ricanements, condescendance pour tous ces « naïfs », « complètement aliénés », « infantilisés », « culturellement régressifs », « idolâtres », « toxicomanes », lobotomisés », « malades mentaux » etc. |
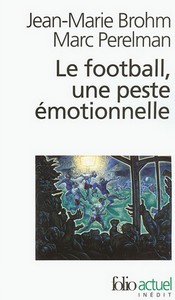 |
« La thèse du sport comme opium du peuple est la thèse centrale de la Théorie critique du sport » (p.57) développée par ces deux penseurs, seuls au monde à l’avoir compris et à échapper à cette « pathologie sociale pandémique » (p.29). Ils veulent donc, dans cet ouvrage publié avant la Coupe du monde 2006 comme refonte de précédents écrits des deux auteurs, faire « comprendre la nature belliqueuse originaire du football, sa logique mercantile et ses fonctions politiques réactionnaires » (p.12) ; pour cela, ils passent en revue l’utilisation du football par des régimes dictatoriaux, les conséquences de l’emprise de l’argent sur ce sport (violences et hooliganisme, dopage), pour enfin lui dénier toute valeur culturelle ou artistique. Fidèle aux conceptions développées par l’ex-« Miroir du football », qui exprimait à la fois une réflexion critique sur l’environnement du football, ses conséquences négatives sur et autour du terrain, ET un combat pour que ce jeu participe aux aspirations des hommes, leur apporte un supplément de vie, nous allons tenter modestement de donner nos positions par rapport à cette attaque politique globale. SUR LE FOOTBALL BUSINESS ET SES CONSEQUENCES Les auteurs, au début du chap.2 intitulé « l’empire du football », citent (en ne pouvant s’empêcher d’ironiser par un « sic » sur ce qui n’est que le constat d’une réalité !) une phrase de F. Thébaud, dans son livre sur Pelé, présentant le développement universel de ce sport: «Le football n’est pas une mode, un engouement passager. Il est né en Angleterre il y a plus d’un siècle. Et comme tout organisme vivant [sic] il a subi l’empreinte des conditions climatiques, géographiques, économiques, historiques, sociales particulières aux milieux divers dans lesquels s’est effectué son développement ». On peut en gros les suivre dans la précision qu’ils y apportent : « La naissance, l’extension et l’implantation du football sont en effet totalement déterminés par le développement du capitalisme, puis de l’impérialisme en tant que conquête du marché mondial, et ses cycles d’expansion ont toujours été liés aux grandes périodes d’évolution de l’économie capitaliste ainsi qu’aux rapports de forces politiques sur l’arène diplomatique internationale. De nos jours, c’est bien entendu dans le cadre de la mondialisation libérale et de la domination du capital financier transnational que prospère le football… » (p.62). Tout le chapitre 2 rappelle des réalités sur le « football business », à savoir la logique du profit (ou recherche d’ »image ») chez les propriétaires de clubs (grandes entreprises, fonds d’investissement ou oligarques russes aujourd’hui) en liaison avec les banques et assurances, chez les sponsors, les équipementiers, les chaînes de télévision et autres medias (journaux, fournisseurs internet, téléphones mobiles), dans le marché des joueurs et leurs salaires délirants, sur les conflits avec la FIFA, l’UEFA pour le partage de la manne financière (droits télévisés sur la retransmission des matches) issue de l’organisation des grandes compétitions, sur les « affaires », scandales financiers et la corruption (que les « paris en ligne » vont vraisemblablement développer !). Tout le chapitre 4, consacré au dopage, revient également sur des « affaires » (procédures judiciaires en Italie, cas éclatant ici ou là), sur la pression exercée sur les joueurs professionnels pour qu’ils « améliorent leurs performances » au détriment de leur santé et « restent compétitifs » malgré la multiplication des matches imposée par le profit. Ce que tentent soigneusement de voiler par intérêt toutes les instances indiquées plus haut. Mais comment l’économie du football pourrait-elle échapper à cet univers capitaliste ? On peut dire la même chose de toutes les formes d’activités humaines dans ce monde tel qu’il va, par exemple de l’école, de la santé… De même pour les arts : cinéma, peinture, musique, littérature etc. Pas plus que le football, ce ne sont « des institutions capitalistes » (p.62), mais des institutions dans le capitalisme, qu’il faut envisager de façon dialectique : offensive capitaliste pour brider leurs potentialités de mieux-être ET résistance collective des hommes pour les développer au mieux de leurs aspirations. La différence du football avec la santé, l’école…, c’est qu’il ne dispose pas de forces organisées (partis, syndicats, associations) pour résister à cette offensive destructrice. Un football totalement libéré ne pourra éclore, à notre avis, que dans un autre régime politique global ; ceci dit, nous pensons qu’une majorité de pratiquants se retrouvent spontanément dans les conceptions « humaines » du sport et du football développées dans l’ex-Miroir, que veut poursuivre le présent site. UN INSTRUMENT D’OPPRESSION ? Pour eux, le sport est un pur instrument du capitalisme : « le principal vecteur ou la pointe avancée de l’économie-monde », (p.198), « l’actuelle mondialisation […] s’appuie essentiellement sur le sport et l’adhésion massive des peuples à son spectacle » (p.198) ; « il est une des principales machineries idéologiques de manipulation, d’endoctrinement et de crétinisation des masses » (p.65) ; « la passion-foot est de même nature psychologique que la peste fasciste » (p.43). Ou encore, s’attaquant au pourtant beau livre d’Eduardo Galeano, Ombre et lumière, « il [= le football] est le Capital » (p.213) Plus même, « c’est bien le football qui écrase tout espoir, toute lutte d’émancipation, en paralysant les revendications sociales » (p.198) ou encore « c’est le football qui empêche toute possibilité de libération et qui anéantit dans l’œuf la moindre revendication sociale ou politique » (p.214). Que dire à cela ? Sinon émettre ces quelques réflexions : ? Le sport en général, le football en particulier ont-ils vocation « à être des lieux critiques de la société » (p.290) ? à organiser les luttes sociales ? Un match de football est-il à même de changer l’ordre du monde ? ? Mais n’est-ce pas insulter l’intelligence de la majorité des joueurs et des spectateurs que d’affirmer qu’ils sont tous des adeptes « du penser foot, parler foot, être foot » (p.31) ? Etre pris par l’intensité d’un match, lâcher leurs émotions pendant une heure et demie les empêche-t-il de garder leur lucidité sur le monde ? Par expérience, on sait que beaucoup d’habitués des stades de football sont les mêmes qui manifestent dans la rue : en 1995 (Sécurité sociale), en 2003 (retraites), en 2006 (CPE) etc, avec d’autres, pas intéressés par le sport ou indifférents au football; et quand ils défilent, ce ne sont pas la FIFA, l’UEFA ou la FFF qui sont les cibles des pancartes ! Une anecdote humoristique à ce sujet aussi : nous avons toujours été amusé par les ruses employées par les présidents de la République lors des finales de Coupe de France pour ne pas être copieusement sifflés à leur arrivée à la tribune officielle (entrer en même temps que les équipes, ou discrètement après le début du match) ; les spectateurs sont-ils dupes des émotions libérées pendant le match ? Pensent-ils que cela va changer leurs conditions de vie le lendemain ? ? Bref, on peut avoir une pensée sur la société (y compris sur le football !), le monde, la politique, s’engager dans la société ET aimer le football, sans y voir une contradiction ni avoir mauvaise conscience, contrairement à l’affirmation : « penser au football, c’est ne penser qu’à cela, c’est-à-dire s’arrêter de penser » (p.310). UN SPORT PAR ESSENCE VIOLENT? Mais pour eux, le football est régressif par essence, par sa nature même : « le football est l’école de la guerre » (p.29) ; et de manière récurrente ils dénoncent « la guerre en crampons qui fait rage toutes les semaines sur tous les terrains du monde » (p.120). Ils portent constamment une vision caricaturale, présentée comme systématique, des motivations des joueurs quand ils entrent sur le terrain : « l’affrontement physique bestial […] avec sa rage de cogner qui transforme les footballeurs dopés par l’enjeu en machines à accrocher, bousculer ou faucher l’adversaire, en loubards des pelouses habités à tirer les maillots et distribuer coups de pied, de coude et de tête » (p.128) ; « est-il possible de présenter comme un art le fait de perforer l’adversaire, de saccager ses tibias, de le tacler sauvagement ? » (p.311). C’est par sa nature même qu’il déclenche « cette sourde violence _ omniprésente, endémique, diversifiée _ qui accompagne les matches de football, des grandes rencontres internationales aux plus petits tournois amateurs » (p.123) ; ils martèlent : « c’est bien le football, et lui seul, qui suscite, favorise le tropisme de la violence » (p.145) ; « le football est bien une incitation permanente aux violences verbales et physiques, éructations de haine et de débordements criminels » (p.120). Ici encore, nous ne sommes pas angéliques et connaissons ces faits de violence dans et autour du stade (rappelés principalement dans le chapitre 3 sur les exactions des « hooligans », présentés comme la totalité des spectateurs, et égrenées tout au long de l’ouvrage). Nous rétorquons par expérience (longue pratique du football, fréquentation régulière des stades ou regard des matches à la télévision) que présenter les bagarres rangées de joueurs sur le terrain, les violences des « supporters » de certaines équipes professionnelles comme la généralité de tous les stades du monde nous semble outrancier et de mauvaise foi. Ce faisant, nous nous plaçons dans la continuité du Miroir du football, qui mettait en avant la joie de jouer, liée au football offensif, le respect de l’adversaire, dans une pratique qui n’est qu’un jeu, et c’est déjà beaucoup. Une position qui nous fait aujourd’hui encore combattre « le résultat par tous les moyens » (tricheries, violences), les affirmations du type « le football, c’est la guerre », les dispositifs ultra-défensifs … Une position qui nous fait à nouveau militer pour la réflexion tactique, l’intelligence dans le jeu, individuelle et collective, l’imagination et la créativité pour vaincre l’équipe adverse, car oui, l’objectif du football comme de tout sport de compétition, c’est de se confronter à un adversaire et tenter de gagner, en marquant plus de buts que l’adversaire ; et ce dans le cas d’une violence maîtrisée, cadrée par les lois du jeu, comme l’explique par exemple le sociologue allemand Norbert Elias, qui voit dans le sport une avancée de civilisation par rapport à la guerre. Mais cela, pour nos deux « révolutionnaires », c’est une « légende pour demeurés » (p.222) En nous attachant à la dimension politique de l’ouvrage de J-Marie Brohm et M. Perelman, nous avons laissé une partie de celui-ci dans l’ombre: constamment dans celui-ci, dans une synthèse au chapitre final, intitulé « Culture foot et football art : la mystification populiste », ils refusent toute valeur artistique au football et lui dénient toute prétention culturelle. Cette problématique mériterait un autre développement. Disons que le football est un sport, un jeu qui n’a pas la prétention à être un art d’une part, et que d’autre part son inscription sociale historique dans les classes populaires et son développement universel l’ont amené à s’inscrire culturellement dans notre monde. Et puis jouer au football, regarder un match participe de cette « part gratuite » (G. Bataille) proprement humaine, où nos activités échappent au règne de la nécessité (travailler, consommer…) ; c’est vrai de bien d’autres moments de notre existence : marcher dans la nature, jouer un instrument, lire, ne rien faire et rêver, se réunir entre amis etc UNE POSITION MANICHEENNE Une dernière réflexion : le lecteur des citations de l’ouvrage placées dans ce compte rendu l’aura constaté, les auteurs, qui reprochent à leurs antagonistes une subjectivité « aliénante » dans leur regard sur le football, adoptent un style, un registre qui dépassent la vigueur polémique, pamphlétaire (redondance d’un vocabulaire hyperbolique, de comparaisons dévalorisantes, de superlatifs) ; insultant systématiquement leurs contradicteurs, ils interdisent tout débat, en proie à ce qu’il faut bien appeler une ferveur religieuse, la fièvre de prêcheurs imprécateurs, de sectateurs porteurs de leur foi anti-football : ainsi « le passionné de football est un possédé » (p.32) [par le diable ?] ; ou cet argument curieux dans le chapitre 7 déniant toute valeur culturelle et artistique au football, quand ils comparent un stade et une cathédrale : «Un stade est en effet un lieu profane fonctionnel dont la finalité est commerciale, tandis qu’une cathédrale est un lieu sacré conçu, reçu et perçu comme œuvre d’art, dont la finalité est la célébration de la transcendance, à l’instar de celle de Saint-Denis si proche du Stade de France, édifiée à partir du XIIe siècle à l’initiative de l’abbé Suger » (p.304). Nous comprenons qu’on puisse ne pas aimer le football, mais à cette intolérance, nous préférons l’ironie malicieuse d’un Pierre Desproges dans son sketch « A mort le foot ! » ou l’humour d’Umberto Eco dans le passage de La guerre du faux cité (p.20) dans l’ouvrage. PS : A l’occasion d’une attaque personnelle à J-Claude Michéa, auteur de Les intellectuels, le peuple et le ballon rond, les auteurs lancent une calomnie au Miroir du football (« des souvenirs liés à un passé stalinien _ le soi-disant inégalé Miroir du football » p.217), difficile à accepter pour qui a connu un tant soit peu François Thébaud (ayant rompu avec le stalinisme dès les années 30), son acharnement à préserver l’autonomie et la liberté de pensée du magazine qu’il avait fondé vis-à-vis de ses éditeurs liés au PCF, ce qui entraînera d’ailleurs le conflit avec la direction en 1974, son départ en 1976 suivi par celui de presque tous ses collaborateurs, et la chute de ce journal d’exception devenu alors comme les autres cf son ouvrage Le temps du Miroir (ed. Albatros 1982). Loïc Bervas (mai 2010) |